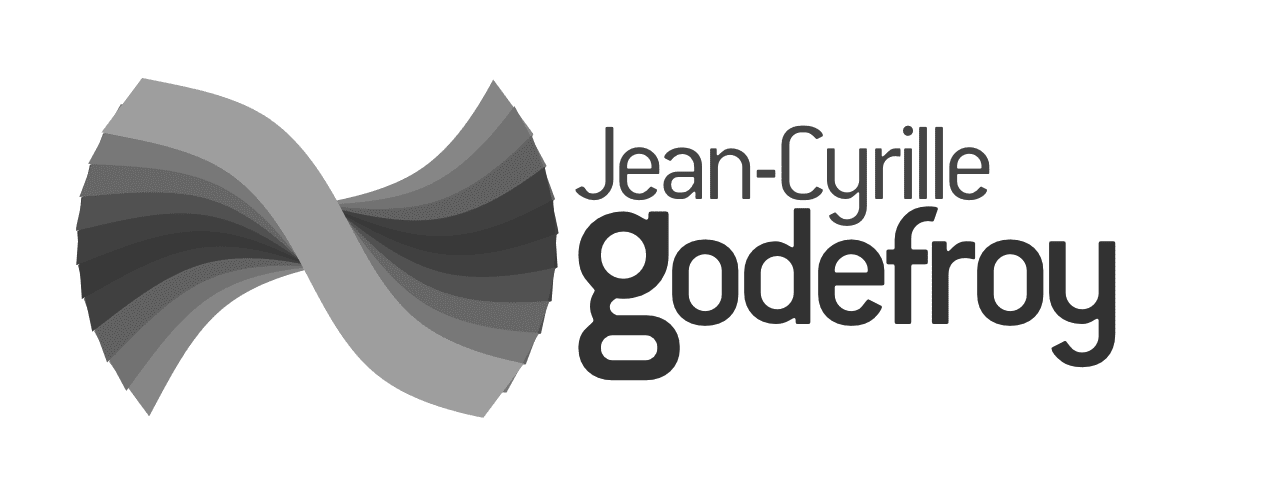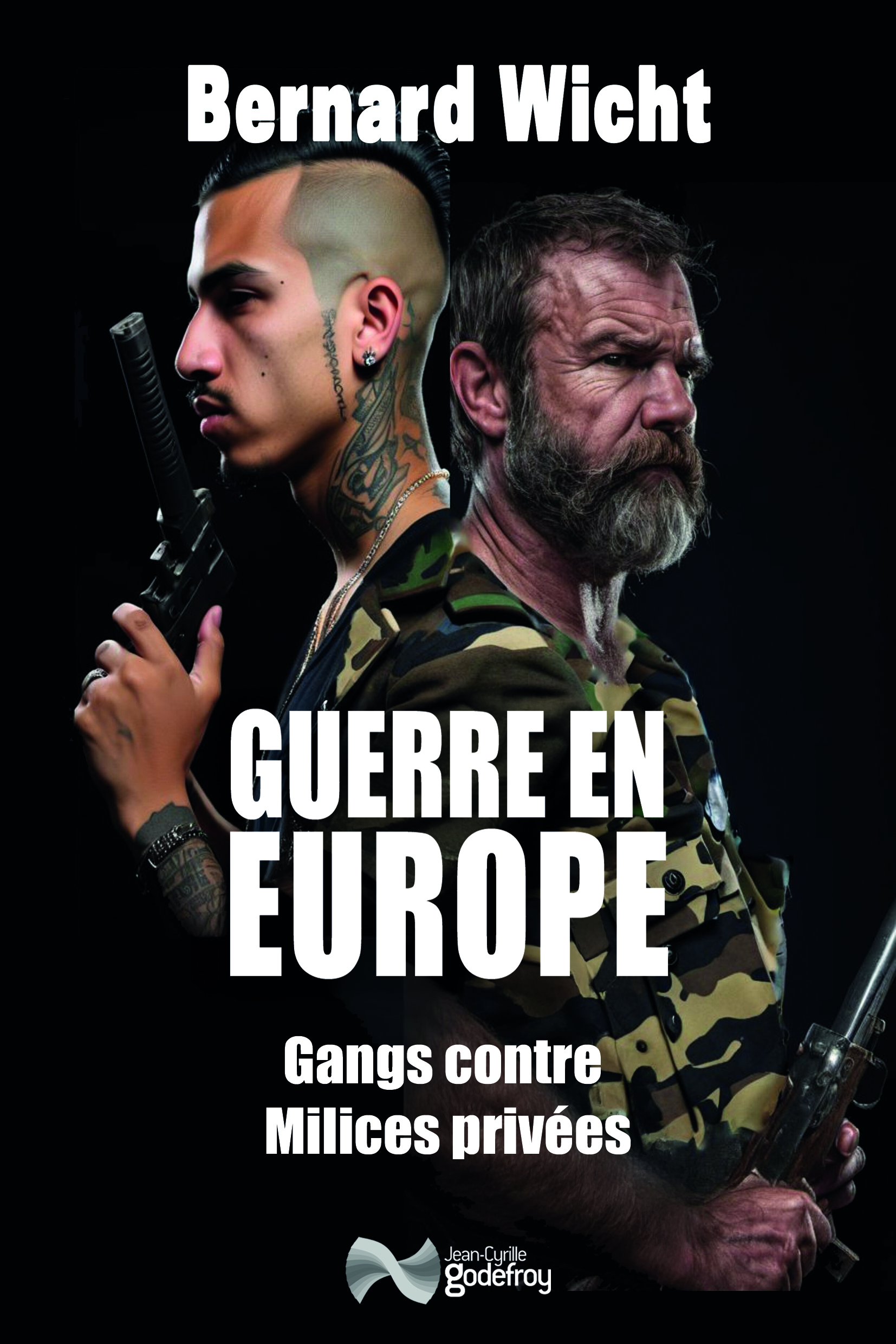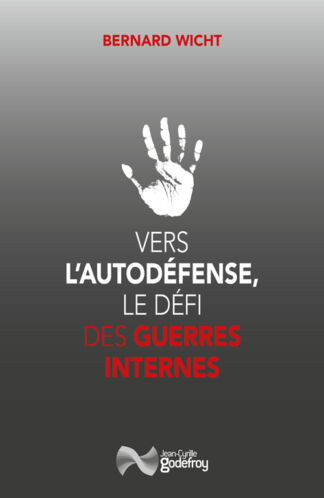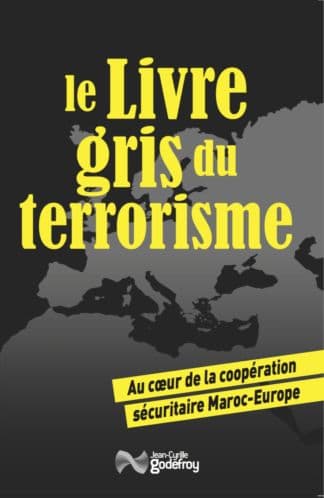Préface d'Eric Werner
« La guerre est un caméléon », lit-on dans Clausewitz. Autrement dit, la guerre n’est pas une idée platonicienne, elle ne cesse au contraire de se transformer au fil du temps, de changer de visage. Il y a donc un risque, celui d’être en retard d’une guerre. Exemple souvent cité : l’épisode de mai-juin 1940, qui vit la désintégration, en moins de six semaines, de l’armée française, sous l’effet de la percée allemande des Ardennes. « Nos chefs ou ceux qui agissaient en leur nom n’ont pas su penser cette guerre », résumera ainsi Marc Bloch dans L’Étrange défaite (1).
Toutes choses égales d’ailleurs, les mêmes problèmes se posent aujourd’hui. C’est le sujet de ce livre.
On peut aisément s’aveugler en la matière. Dans ses Mémoires de guerre, le résistant Henri Frenay relève ainsi à propos du général de Gaulle : « De Gaulle était sûrement le prophète de l’emploi de l’arme blindée dans une bataille classique, mais (…) il n’avait pas la moindre idée de ce que pouvait être la guerre de guérilla, caractérisée (…) par des initiatives individuelles et l’impossibilité, dès le déclenchement des opérations, de les soumettre à un commandement centralisé » (2).
De Gaulle avait vu venir l’arme blindée, non en revanche la guerre de guérilla, qui joua pourtant un rôle important au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Avec la guerre de guérilla, la guerre, effectivement, change de visage. La « bataille classique » disparaît pour faire place aux embuscades, aux conduites de raids, aux actions de harcèlement, etc. La guerre se dilue donc dans l’espace, mais aussi le temps. Comme le relève en outre Henri Frenay, une grande marge d’initiative est laissée aux individus. Guerre, enfin, qu’on peut qualifier de totale, car elle se mène à tous les plans : militaire, d’une part, mais aussi mental et psychologique.
À certains égards, la guerre de guérilla a été la forme de guerre la plus importante en notre temps. On vient d’évoquer la Deuxième Guerre mondiale, mais on pourrait aussi évoquer les décennies qui ont suivi, celles marquées par le processus de décolonisation.
En réaction, la guerre de guérilla engendra la contre-guérilla, qui fut théorisée en France à l’époque de la guerre d’Algérie, avant, dans les années 70, que les Américains ne se l’approprient pour mener leurs propres guerres à eux à travers le monde (en Amérique latine notamment). La contre-guérilla emprunte nombre de ses traits à la guerre de guérilla, mais en les retournant contre elle, selon le principe de l’adaptation mimétique (3). Elle trouve aujourd’hui son prolongement dans la « guerre contre le terrorisme », guerre s’appuyant sur le contrôle social généralisé et l’utilisation à très large échelle des nouvelles technologies numériques. En arrière-plan, on assiste à la montée en puissance des services spéciaux, qui sont aujourd’hui le « cœur » même de l’État, son noyau central.
Si Clausewitz dit que la guerre est un caméléon, il est aussi connu pour avoir dit qu’elle était poursuite de la politique par d’autres moyens. Certaines guerres actuelles répondent encore à cette définition : les deux qu’on vient de mentionner notamment (guerre de guérilla et antiguérilla : l’une comme l’autre sont poursuite de la politique). D’autres, en revanche, beaucoup moins. Il en est ainsi de celles qui sont à elles-mêmes leur propre fin : détruire pour détruire, tuer pour tuer, etc. Tuer pour tuer n’est pas toujours ce qui est voulu au début. Mais on en vient progressivement parfois à le vouloir : la guerre se nourrissant d’elle-même. Dans un de ses derniers livres, Bernard Wicht dit que si le XXe siècle a été le siècle du totalitarisme, le XXIe pourrait bien se révéler être celui de l’extermination (4).
Autre cas de figure encore, celui lié à la hausse de la criminalité dans l’ensemble de nos pays, hausse génératrice d’un sentiment d’insécurité qui fait qu’on est parfois amené à comparer l’état de choses actuel à la crise du Ve siècle de notre ère, marquée par les invasions barbares et la désintégration de l’Empire romain, ou encore, comme le fait ici même Bernard Wicht, à la période post-carolingienne : les débuts de la féodalité. On pourrait aussi faire le parallèle avec la période prérévolutionnaire en France, telle que la décrit Taine dans Les Origines de la France contemporaine. Le problème ici qui se pose est celui des rapports entre guerre et criminalité. On n’aime pas trop, parmi les spécialistes, associer la criminalité à la guerre, mais la frontière entre les deux domaines n’est pas toujours très claire. En témoigne le parcours de vie de certains terroristes, qui commencent par se livrer à de petits trafics avant d’en venir à égorger les gens dans la rue au nom de la religion. La criminalité n’est pas complètement sans lien non plus avec la politique, mais c’est un lien indirect. Les délinquants et les criminels utilisent parfois la politique pour soigner leur image (on l’a vu par exemple en France lors des émeutes urbaines de juin 2023). La politique leur sert en l’occurrence d’alibi, de justification a posteriori. De leur côté, les autorités prennent volontiers prétexte de l’explosion des chiffres de la criminalité pour resserrer un peu plus encore leur étau sur la société, faire voter de nouvelles lois répressives, etc.
À partir de là, on pourrait dire que plusieurs guerres se partagent aujourd’hui l’espace public — se le partagent, et donc aussi interfèrent entre elles : clausewitziennes et non clausewitziennes, régulières et irrégulières, symétriques et asymétriques, internes et externes, horizontales et verticales, high cost et low cost, ethniques et idéologiques, etc. Elles interfèrent entre elles, et naturellement aussi s’interpénètrent, s’hybrident. C’est un grand mélange d’un peu tout. Souvent même, un certain nombre de ces guerres se mènent au même moment et au même endroit, avec des effets forcément cumulatifs. C’est ce qu’on voit par exemple au Moyen-Orient — mais il est très possible qu’il en aille un jour de même en Europe, si la situation actuelle (encore une fois, marquée par un climat de violence allant se répandant) continuait à se dégrader. L’image de l’embrasement acquiert ici sa pleine signification.
C’est à cette réalité même, complexe, enchevêtrée, bien souvent donc aussi insaisissable, que l’individu se trouve aujourd’hui confronté.
On parle ici de l’individu, car, de plus en plus, à notre époque, l’individu est amené à prendre lui-même certaines décisions. Autrefois c’était l’État qui les prenait. Entre autres et en particulier, c’est lui qui faisait la guerre : lui et lui seul. Il en va différemment de nos jours. L’État continue certes à faire la guerre, mais il n’est plus désormais seul à la faire. Bien d’autres entités également la font : elles, non étatiques (services de sécurité privés, organisations terroristes ou criminelles, etc.). Et parfois aussi, justement, l’individu lui-même. Quand on parle de la guerre qui est un caméléon, c’est ce dernier point qui devrait le plus nous retenir.
Normalement, il incombe à l’État d’assurer la protection des individus. C’est une de ses tâches principales. Sauf, d’une part, que l’État se montre de moins en moins aujourd’hui à la hauteur en ce domaine : il ne nous protège plus de grand-chose. L’autodéfense s’impose dès lors comme une alternative naturelle. D’autre part, on ne sait plus très bien quel jeu joue aujourd’hui l’État. Il y a une trentaine d’années déjà, Alexandre Zinoviev dénonçait la porosité croissante de la frontière entre l’État et les groupes mafieux ou criminels. Au mieux il reste passif, laisse les choses se faire. Mais parfois cela va plus loin. L’État n’en est pas encore, à proprement parler, comme en Amérique latine, à collaborer avec les groupes en question, mais quand on voit les progrès du clientélisme en certains pays européens, ceux notamment gangrenés par le narcotrafic, l’islamisme, ou les deux à la fois, on n’échappe pas à l’impression selon laquelle l’État joue parfois double jeu.
Enfin et surtout, l’État lui-même est assez clairement aujourd’hui perçu comme une menace. On a évoqué plus haut la guerre contre le terrorisme : concrètement, cette guerre prend de plus en plus la forme d’une guerre de l’État contre sa propre population, comme le montre la fragilisation à l’extrême de l’habeas corpus et certaines atteintes souvent gravissimes aux droits individuels. Pour reprendre les termes de Bernard Wicht, l’État est devenu « pénal-carcéral ». Cette dérive ne date pas d’hier, mais un seuil critique a, semble-t-il, été franchi ces dernières années.
L’individu se retrouve dès lors seul face à lui-même. C’est une situation inédite, mais à laquelle, peut-être, l’individu est moins mal préparé qu’on ne le penserait de prime abord. Comme le dit C.G. Jung, l’individu acquiert aujourd’hui « une signification naguère ignorée. Il ne sera plus dorénavant uniquement son moi bien connu et socialement défini, mais aussi l’instance qui négocie ce qu’il vaut en lui-même. » (5) En d’autres termes, c’est lui, désormais, qui prend les décisions. Personne d’autre ne saurait le faire à sa place. C’était peut-être le cas autrefois encore. Mais plus maintenant. Il sait également « ce qu’il vaut » et n’obéira donc pas à n’importe quel ordre. On est donc en présence de deux lignes évolutives distinctes, mais qui, en fin de compte, se rejoignent.
Quand on dit que l’individu est aujourd’hui le sujet de la guerre, cette formulation n’acquiert sa pleine signification que si on la relie à cette autre selon laquelle l’individu est de nos jours « l’instance qui négocie ce qu’il vaut en lui-même ».
Lui dénier cette capacité-là, voire tout simplement l’ignorer ou la sous-estimer, ce serait, en 2025, être en retard d’une guerre.
Éric Werner
NOTES :
(1) Marc Bloch, L’étrange défaite, Gallimard, folio, 2016, p. 66.
(2) Henri Frenay, La nuit finira, t. I, Le Livre de poche, 1974, p. 489.
(3) Cf. Mathieu Rigouste, Préface à : Carlos Marighela, Manuel du guérillero urbain, Libertalia, 2022, pp. 9-50.
(4) Bernard Wicht, Vers l’autodéfense. Le défi des guerres internes, Jean-Cyrille Godefroy, 2021, pp. 59-60.
(5) C. G. Jung, « Ma vie » : Souvenirs, rêves et pensées, Gallimard, folio, 2012, p. 542.