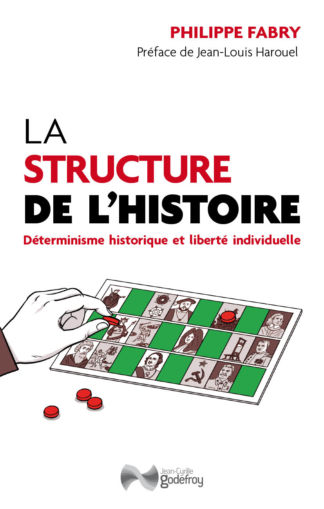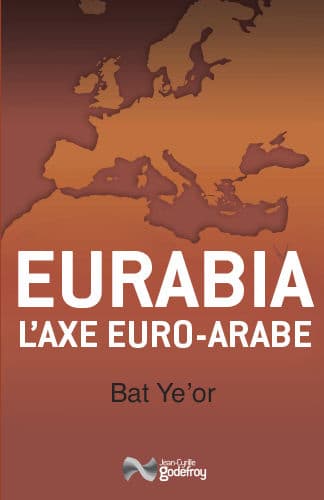Description
Plus qu’aucun autre pays européen, la France fait usage de ses forces armées, engagées sans relâche dans des « opérations extérieures » au long cours dont il est parfois difficile de discerner la cohérence d’ensemble. En tête des institutions préférées des Français, qui voient en elles une valeur refuge dans une société désorientée, les Armées ont vu disparaître le climat d’antimilitarisme des années 1970. Mais l’opprobre n’a pas été remplacé par une meilleure compréhension de ce qui guide l’action de guerre.
Or la remise en cause, violente, du cadre des relations entre les États, et désormais des structures mêmes de nos sociétés, nous impose de comprendre. Elle commande de penser la stratégie, et d’approcher ce que signifie être et agir en homme de guerre : pas seulement en militaire, mais bien en citoyen face aux périls menaçant sa Nation, en être humain face à l’inéluctable tragédie de la Politique.
Un monde nouveau émerge, dans les fracas du terrorisme et de la guerre économique, au rythme de « crises » protéiformes. Pour nous, Français, ce monde neuf nous projette paradoxalement vers des horizons anciens, où se pose la question de la survie, et où la victoire est parfois le seul chemin vers la paix. Mais pour y parvenir, il nous faudra toutefois nous montrer capables à nouveau de penser, et de faire la guerre.
C’est l’ambition de ce bréviaire : donner accès aux mots de la guerre, les rendre familiers au travers d’articles courts et enlevés. Avec une conviction : la guerre est chose trop sérieuse pour ne pas être entendue.
Collection Cercle Aristote, dirigée par Pierre-Yves Rougeyron
Préface de Michel Goya
Stratégie à tous les étages.
Il y a quelques années lors d’un colloque à Paris quelqu’un avait demandé à un officier général de l’État-major des Armées si « les militaires étaient capables de répondre aux demandes du politique ». Le général avait répondu « oui, bien sûr ». Une question et une réponse qui n’avaient en réalité guère de sens, en l’absence de tout contexte et de tout ennemi, actuel ou potentiel, désigné, bref tout ce qui permet de réfléchir à une véritable stratégie.
Ce dialogue ressemblait d’une certaine façon à celui des deux Livres blancs de la Défense et de la Sécurité nationale » de 2008 et 2013 se contentant de demander aux armées des contrats de déploiements, avec des volumes de soldats et équipements majeurs à déplacer à telle distance et dans tels délais, volumes par ailleurs toujours plus petits et délais toujours plus longs, mais sans jamais préciser pourquoi y faire et surtout face à qui. Si la force armée, la « force publique extérieure » selon le comte de Guibert, peut être employée à de nombreuses missions, elle est fondamentalement conçue pour faire la guerre, c’est-à-dire l’affrontement violent d’une entité politique contre une autre. Le terme « stratégie » est employé à tort et à travers, pour désigner la simple mise en cohérence entre des fins et des moyens mis en œuvre, en oubliant, et ce qui la différencie de la programmation, une intelligence et une volonté antagonistes.
Ces deux Livres blancs n’exposaient donc pas une vision stratégique pour la France, mais effectuaient un panorama des relations internationales, établissaient une liste de risques et de menaces contre la France, toujours la même, et définissaient ensuite le volume des forces à atteindre à un horizon défini ainsi qu’un échelonnement du financement des grands programmes d’armement. Par un paradoxe dont l’étrangeté n’était qu’apparente, la première partie de ces documents se terminaient toujours par le constat que « le monde est plus dangereux » et la seconde commençaient par « voici comment on va réduire les budgets et les moyens », tant il est vrai que les économies à réaliser dans le budget de défense ont été la seule vraie vision à long terme jusqu’en 2015, lorsque ce qui était écrit dans les textes est devenu une réalité dans les rues de Paris.
Nul objectif de puissance à atteindre et nul plan d’emploi des forces pour y parvenir face à des adversaires possibles. La dernière vision de ce genre date des débuts de la Ve République sous l’impulsion du général de Gaulle, pour qui l’absence de grande politique alors que nous n’étions plus une grande puissance aurait abouti à n’être plus rien. Depuis la fin de la guerre froide et même depuis les années 1980, cette grande politique n’est plus, remplacée par un emploi « à la demande » des forces armées et rarement pour affronter directement des ennemis. C’est ainsi que l’on empile les opérations militaires, parce que c’est facile bien plus que parce que c’est efficace, et c’est ainsi aussi que l’on se trouve avec un outil militaire managé à court terme plutôt que conduit vers des objectifs clairs et ambitieux.
Alors que « nous sommes en guerre », selon les termes du Premier ministre Manuel Valls en 2015 (omettant toutefois de nommer l’ennemi), la France n’engage que moins de 3 % de ses soldats directement face à l’ennemi. C’est moins que ce qui est déployé sur le territoire métropolitain, en permanence depuis vingt-cinq ans maintenant, en concurrence avec le ministère de la « force publique intérieure » pour reprendre Guibert, dont la sécurité est la mission hors de tout contexte politique et même vraiment dialectique. Les forces de police ne sont pas là pour imposer sa volonté à un interlocuteur politique, mais pour maintenir l’ordre et réprimer les contrevenants à la loi, une mission qui ne se termine ni par un traité de paix ni par la destruction de l’autre, et risque donc d’être éternelle.
La confusion entre les deux missions est devenue courante depuis la fin de la guerre froide. Comme l’explique parfaitement Benoist Bihan, lorsqu’il y a un « nouvel ordre mondial », il y a un ordre à maintenir et tous les perturbateurs sont considérés comme des contrevenants à la loi qui doivent être réprimés, depuis les États « voyous » jusqu’au « terrorisme ».
Il est temps, et même urgent, de sortir de la confusion maintenant que des organisations armées puissantes ennemies et des États concurrents ont, eux, une réflexion stratégique. C’est ce à quoi nous invite Benoist Bihan à travers ce recueil de chroniques publiées pendant six ans dans les pages du magazine Défense & Sécurité internationale.
La stratégie est une praxéologie, une discipline à l’instar de la médecine par exemple, qui s’appuie sur une étude longue d’invariants ou au moins de « peu variants » et la confronte à des contextes toujours changeants. Cette étude est d’abord inductive, et nécessite l’analyse de faits issus de l’observation des conflits en cours, avec le risque du manque de recul, et de l’Histoire, avec le risque de l’inadéquation aux contextes du moment, de fait surtout lorsqu’on descend de l’échelle de la stratégie vers la tactique. Elle s’appuie aussi sur la lecture des classiques, dont on rappellera que si leur capacité interprétative a résisté au temps, il est fort probable qu’elle le fera encore longtemps, au contraire de beaucoup de concepts actuels, pour la plupart venu des États-Unis.
Les 58 courts textes de cet ouvrage sont comme des pions de Go qui finissent en s’accumulant par former des trames, et embrasser l’ensemble du champ des opérations, ces endroits vastes où on s’efforce d’obtenir des effets stratégiques à partir d’actions tactiques, de combats, batailles, démonstrations de forces, etc. On parvient ainsi à articuler les principes de toujours avec les formes guerrières d’aujourd’hui, le long d’une séquence qui part de la Grande stratégie jusqu’aux différents modes opératoires des stratégies organiques, la gestion des moyens, et opérationnelle, leur mise en œuvre.
Ce sont les nations et non pas les armées qui font les guerres, et il est important de fournir au public intéressé les éclairages dont il a besoin pour comprendre les conflits en cours et particulièrement la manière dont ses soldats y sont employés. On peut même espérer aussi qu’il soit lu également par les responsables politiques, ceux-là mêmes qui vont justement employer la force armée, alors que leur compétence stratégique est de plus en plus faible. Mais il sera également lu avec le plus grand intérêt par ceux — les militaires — qui sont employés.
La France a plus que jamais besoin d’un renouveau de sa pensée stratégique, La guerre, la penser et la faire de Benoist Bihan y contribue pleinement.
Michel Goya
Table des matières
TABLE DES MATIERES
Préface de Michel Goya
Introduction
Considérer
Grande stratégie
Géo-stratégie
Le syndrome du bon élève
Les armées servent, d’abord, à faire la guerre
Les forces armées sont un outil
Les limites de la stratégie sur atlas
La « période initiale de la guerre »
Comprendre
Du danger des « évidences » historiques
De la force des armées
Y a-t-il des principes à la guerre ?
Dangereux archaïsmes
Des exemples choisis. Pensée militaire et manipulation de l’histoire
Qu’est-ce qu’une armée performante ?
« L’approche indirecte », histoire d’une imposture
Imaginer
Avoir le temps. Penser la durée comme outil stratégique
« Souple, félin et manœuvrier » ?
Le culte des forces légères en France et ses conséquences
L’élévation vers la stratégie
Stratégie durable
Réformateurs militaires
Doctrines importées
Libérer la pensée stratégique pour limiter la guerre
Mobiliser
Préparer la guerre
De la mobilisation générale à la mobilisation intégrale
Le charme dangereux des petites armées
Stratégie des moyens humains
Polyvalence
Opinion publique et stratégie
Organiser
Masse critique
Élaborer une stratégie nationale : une question de méthode
Aux sources de la supériorité militaire
Airlift : Un fantasme militaire exemplaire
Réhabiliter l’organique
Distribution stratégique des forces
Stratégie et doctrines militaires
Décider
Leadership stratégique
Embrasser l’incertitude
Les temps de la décision
Mission Creep
Le commandement, reflet d’une conception de la guerre
Organiser le commandement
Mésestimer l’adversaire
« Solution militaire »
Frapper
Repenser l’attrition
Opérations sur les perceptions
Frappes de décapitation ?
Usure et anéantissement
La diplomatie comme moyen de la guerre
Organisations combattantes
Vaincre… ou pas
De la victoire
Escalades vers la défaite
Les conséquences stratégiques des insurrections
Les conséquences des guerres lointaines
Expéditions punitives
La possibilité d’une défaite
Les limites des guerres sous-traitées
La crise du modèle expéditionnaire
Du danger des "évidences" historiques
Du danger des « évidences » historiques
Il n’est sans doute rien de plus dangereux que les certitudes lorsque celles-ci se fondent sur un examen superficiel, partiel ou — plus grave encore — partial des événements. Or, nombre de faits historiques qui continuent d’être considérés comme des évidences sont de cet ordre. Ils conduisent la pensée stratégique à tenir pour certains des enseignements qui reposent en fait sur une analyse erronée.
En effet, lorsqu’une interprétation simpliste, ou orientée, conduit à tirer des enseignements au mauvais niveau, le risque est grand de voir les enseignements tirés de l’histoire être sinon totalement erronés, du moins partiellement faux et incomplets. La pensée qui s’en nourrit s’en trouve alors à son tour irrémédiablement faussée, avec des conséquences pouvant être sérieuses.
L’armée prussienne en 1806
La manière dont est aujourd’hui très largement perçue la défaite prussienne de 1806 montre à quel point une analyse initiale orientée peut affecter la perception d’un événement et biaiser pour longtemps les leçons pouvant être tirées de cet événement.
Il est aujourd’hui encore admis comme une évidence que la défaite retentissante de la Prusse face aux Français, en octobre 1806 lors des deux batailles simultanées de Iéna et d’Auerstädt, est toute entière due à l’emploi par les Prussiens de tactiques obsolètes, strictement identiques à celles de l’armée de Frédéric II un demi-siècle plus tôt. L’armée prussienne, armée sclérosée d’ancien régime composée en majeure partie de mercenaires et déployée en de minces et rigides lignes de bataille, se heurte à une armée française de citoyens-soldats, au déploiement par division plus souple, aux tactiques plus flexibles et mobiles, à l’équipement — fusil d’infanterie et artillerie en particulier — plus moderne. Dépassée, l’armée du roi de Prusse ne peut résister à celle de Napoléon Ier, et le résultat, joué d’avance, est la défaite retentissante et l’humiliation de la Prusse par la France.
Cette lecture de l’événement — le choc des Anciens et des Modernes, à l’avantage des seconds — est pourtant fausse. L’étude de l’évolution de l’armée prussienne entre la fin de la guerre de Sept Ans, en 1763, et la défaite de 1806 montre au contraire une armée où la réforme tactique et technique non seulement existe, mais est parfois plus importante que dans d’autres pays, y compris en France. Loin d’être incapable de se déployer autrement qu’en ligne de bataille, l’infanterie prussienne est ainsi l’une des premières, dès 1788, à se doter d’un manuel moderne d’emploi des troupes légères, une innovation que l’armée française elle-même n’intégrera qu’à partir de 1791.
Et les soldats du roi de Prusse sont loin d’être des mercenaires. Cette image héritée de la fin de la guerre de Sept Ans où Frédéric II, aux abois et ayant subi de lourdes pertes, recrute effectivement — souvent de force — des soldats de toutes origines, est fausse au début du XIXe siècle, où la composition de l’armée prussienne est également répartie entre des Inländer — conscrits effectuant leur service militaire dans leur canton d’origine — et des Ausländer, soldats « professionnels » dont l’origine est certes parfois étrangère, mais plus souvent encore sont des Prussiens originaires d’un autre canton (land) que celui où est caserné le régiment.
Enfin, le matériel prussien est aussi moderne que celui de ses adversaires français. Le fusil, adopté en 1740, mais lourdement modifié en 1782, est certes inférieur en précision à l’armement des fantassins français, le fameux Modèle 1777 corrigé An IX (1801), mais est l’équivalent des fusils britanniques ou autrichiens. De même, l’artillerie prussienne est modernisée en 1787 : si elle est moins mobile que son homologue française, elle n’est en aucun cas un vestige du passé.
Certainement inférieure et moins expérimentée que la Grande Armée, l’armée prussienne en 1806 n’est pourtant pas le vestige militaire de l’Ancien Régime que l’on voudrait en faire. L’évidence de la défaite d’une armée par une autre lui étant supérieure tactiquement a en réalité été fabriquée par les réformateurs de l’outil militaire prussien entre 1806 et 1813, puis reprise par la suite dans le discours nationaliste allemand.
En attribuant la victoire napoléonienne non à la qualité et au talent des soldats et des chefs français, mais à la sclérose intellectuelle des tacticiens prussiens, il s’agissait de diminuer le mérite de l’adversaire. En expliquant la défaite par des facteurs tactiques et techniques, il s’agissait de justifier des réformes militaires. En insistant sur l’opposition entre « mercenaires » prussiens et citoyens-soldats français, il s’agissait enfin de favoriser la mise en place en Prusse d’une conscription similaire à celle de la France. Mais, surtout, confiner les causes de la défaite à des facteurs techniques, tactiques et à l’emploi de mercenaires permettait de ne pas engager la responsabilité politique de la monarchie prussienne et de ne pas remettre en cause la structure politique du pays.
La victoire française de 1806 est bien un choc entre l’Ancien et le Moderne. Mais la nature de ce choc n’est pas d’être celui entre deux systèmes tactiques, ni même militaires, mais bien d’abord entre deux systèmes politiques et sociaux. En limitant les leçons à tirer de leur défaite de 1806 aux facteurs militaires, les réformateurs prussiens ont confiné l’ampleur de leur œuvre à cette seule sphère. Avec, pour l’Allemagne, des conséquences sérieuses : en 1918, l’effondrement militaire allemand est comparable à celui de la Prusse en 1806, et l’armée allemande pourtant moderne est vaincue militairement par un adversaire dont l’ouverture politique a permis de mieux comprendre et adapter aux innovations du temps son outil militaire. En ne disputant pas l’interprétation étroite de la défaite prussienne, les historiens comme les stratèges ont ainsi négligé d’étudier l’importance des facteurs politiques dans la victoire ou la défaite d’une armée, pour se confiner à des questions tactiques certes importantes, mais insuffisantes.
La fin des cuirassés
Une analyse par trop simpliste peut aussi biaiser le jugement historique. L’exemple de la disparition du cuirassé de l’ordre de bataille des marines de guerre après 1945 est à ce titre emblématique.
Il est admis aujourd’hui que c’est la vulnérabilité du cuirassé face à l’avion, et particulièrement l’avion embarqué sur porte-avions, qui est à l’origine de la disparition du cuirassé. Le porte-avions aurait ainsi rendu obsolète le cuirassé, et conduit à son retrait au profit de navires de surface plus petits, désormais uniquement consacrés à des missions d’escorte des porte-avions eux-mêmes ou de convois. Cette interprétation, et la perception qu’elle induit du rôle du navire de surface comme un outil très largement défensif, repose sur une lecture linéaire de l’évolution de l’art de la guerre, et en l’occurrence de la tactique navale.
Elle suppose en effet une substitution du porte-avions au cuirassé, et met donc en avant pour expliquer celle-ci des facteurs tactiques et techniques : l’allonge supérieure de l’avion, permettant au porte-avions d’engager le combat à une distance bien plus grande que celle du cuirassé ; le potentiel offensif de l’avion, qui condamne dès 1941 le cuirassé à la destruction ; le fait que la Seconde Guerre mondiale voit la fonction tactique du cuirassé — le combat contre les flottes adverses — être reprise par le porte-avions. Si la première affirmation est vraie, les deux dernières sont plus discutables.
Le potentiel offensif de l’avion est en effet important dès le début de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, l’analyse détaillée des engagements ayant opposé des avions à des navires de ligne montre que ceux-ci ne constituent pas des cibles aussi faciles que l’on pourrait le penser. Les premiers succès des avions contre des cuirassés — comme la destruction par l’aéronavale japonaise des Prince of Wales et Repulse au large de la Malaisie le 10 décembre 1941 — sont pour l’essentiel dus à la faiblesse des défenses aériennes de ces navires. À partir de 1943, le cuirassé devient au contraire un cauchemar pour les aviateurs. Plates-formes stable et vaste, les navires de ligne de l’US Navy, deviennent ainsi le principal navire de défense aérienne de la flotte américaine dans le Pacifique, et les pilotes japonais incapables de s’en approcher sans être détruits évitent de s’y attaquer. Et le potentiel aérien devant être employé pour couler un seul de ces navires est considérable : il faut en 1944 17 bombes et 19 torpilles pour couler le Musashi, tandis que pas moins de 280 avions — plus qu’il n’en avait fallu pour couler les quatre porte-avions nippons à Midway — sont requis pour détruire le Yamato en 1945.
En outre, le cuirassé est pendant la Seconde Guerre mondiale employé dans de nombreuses autres fonctions que le combat d’escadre. Outre une fonction défensive dans ces nouveaux « combats d’escadre » que sont les affrontements aéronavals, les navires de ligne servent au bombardement côtier en préparation d’opérations amphibies, un rôle dans lequel ils excellent. Leur fonction de capital-ship, il est vrai, disparaît. Mais leurs missions, si elles s’inscrivent dans un cadre plus vaste, demeurent importantes, une importance qui justifie le maintien en service — entrecoupé de périodes de réserve — dans l’US Navy des quatre cuirassés modernes de la classe Iowa jusqu’en 1993.
Les véritables causes de la disparition du cuirassé sont en fait davantage économiques que tactiques. Si son utilité, même dans des tâches autres que celles pour lesquelles il a été conçu, ne fait aucun doute, le cuirassé représente un investissement trop élevé alors qu’il existe d’autres moyens moins coûteux d’accomplir ces missions. Plus que le porte-avions, c’est son coût et l’important équipage qu’il exige qui tuent finalement le cuirassé. Alors que le porte-avions, moins cher à fabriquer (en 1945…) est aussi aisément modernisé par remplacement des avions de son groupe aérien, et que sa polyvalence est considérable — pour peu qu’il soit équipé d’aéronefs spécialisés — le cuirassé représente un investissement financier gigantesque alors même qu’il ne remplit que des missions de « niche » que d’autres navires moins coûteux, comme les croiseurs, peuvent également accomplir, certes avec une moindre efficacité.
En se focalisant sur la dimension technologique et tactique, le risque est ainsi grand de négliger l’importance cruciale des facteurs économiques dans la réflexion sur les structures de force. Aujourd’hui, l’US Navy continue de considérer que l’obsolescence du cuirassé est la conséquence de l’ascension du porte-avions ; il en résulte une approche linéaire dans laquelle le porte-avions demeurera nécessairement le capital-ship jusqu’à ce qu’une nouvelle plate-forme ne le remplace. Mais le coût désormais exorbitant de fabrication et d’entretien des porte-avions américains — plus de 15 milliards de dollars pour la seule construction du futur USS Gerald R. Ford (CVN-78) — pourrait condamner le porte-avions à l’extinction, même en l’absence de rival.
Négliger d’étudier un événement ou un phénomène historique dans leur complexité avant de prétendre en tirer des leçons est lourd de conséquences. En fondant une réflexion stratégique sur une appréciation erronée de l’histoire et de ses enseignements, le risque est grand de voir le produit de cette réflexion présenter des failles considérables. En négligeant la dimension politique et sociale, l’armée allemande, enfermée dans la tactique, s’est trouvée au XXe siècle systématiquement en échec stratégique. En minimisant l’importance du raisonnement économique, la marine américaine pourrait voir son fer de lance — ses porte-avions — subir à terme le sort des cuirassés, faute d’avoir réussi à équilibrer leur coût avec leur utilité. Aussi faut-il se méfier des approches utilitaires de l’histoire, comme celle des Prussiens après 1806 — ou celle des partisans américains du porte-avions après 1945. Si l’histoire peut et doit éclairer la stratégie, c’est d’abord en enseignant l’importance de l’analyse complexe, multifactorielle et transdisciplinaire d’un événement pour comprendre celui-ci — et en tirer les bonnes leçons, qui ne sont pas forcément des évidences.