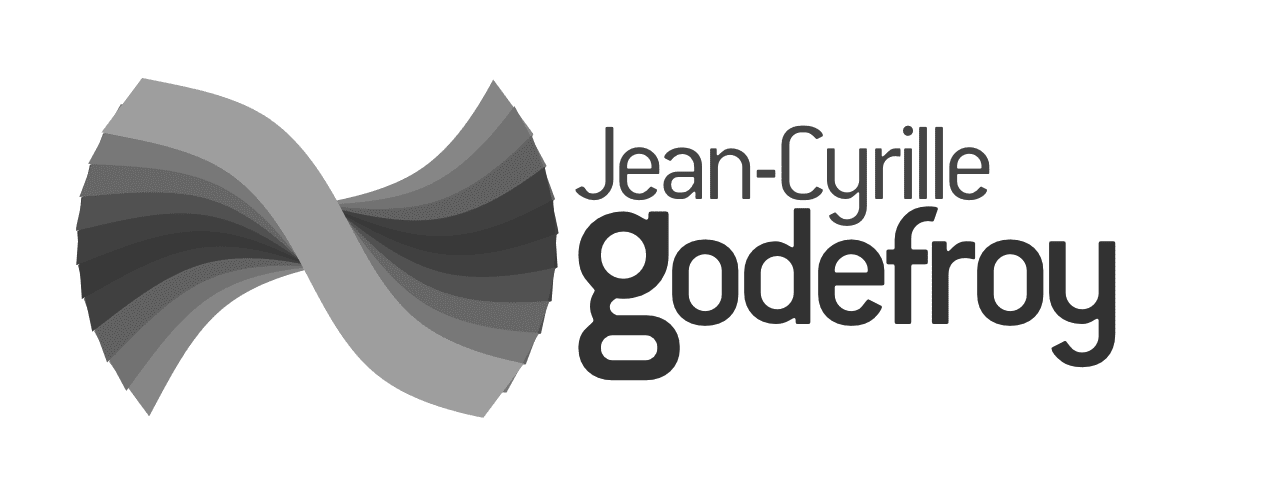Par Roland Lombardi / 27 juillet 2025
L’Édito de Roland Lombardi, Directeur de la rédaction – Le Diplomate Média
Dans une époque qui ne fait plus rêver grand monde, il faut tout de même relever une petite touche positive : les échecs sont à la mode. Alors, en cette période estivale, tandis que certains auront la chance de prendre un peu de vacances et peut-être s’adonner à ce jeu millénaire sous un pin parasol ou entre deux orages, il était bon — et même nécessaire — de revenir sur ce noble jeu, le jeu des rois et des stratèges, à travers le destin fascinant et tourmenté de l’un de ses plus grands maîtres : Bobby Fischer.
En effet, certains hommes ne sont pas faits pour le monde. D’autres le prennent par surprise, lui mettent une gifle stratégique, puis repartent comme ils sont venus, en laissant les diplomates, les généraux et les intellectuels se demander ce qu’il s’est passé. Bobby Fischer, ce petit Américain de 29 ans à la mâchoire serrée et au regard fixe, a battu l’Union soviétique avec un échiquier et une chaise bancale, sans avoir besoin d’un seul avion espion ni d’un discours de l’ONU.
En 1972, à Reykjavík, ce n’est pas qu’un championnat du monde d’échecs qui se joue. C’est le duel symbolique entre deux visions du monde. D’un côté, Spassky, l’homme du système, l’enfant de l’appareil, nourri aux banquets du Parti et aux notes du KGB. De l’autre, Fischer, l’enfant terrible de Brooklyn paranoïaque, surdoué, insupportable, solitaire, mais furieusement libre — et surtout, incontrôlable…
Un Américain à la fois génial… et impossible
Fischer naît en 1943 dans une Amérique sûre d’elle-même et qui s’apprête à dominer le monde…
Très vite, il se révèle obsédé par les échecs comme d’autres le sont par la vodka ou le pouvoir. Il ne parle que ce langage. Champion des États-Unis à 14 ans, Grand maître à 15 ans, il ridiculise déjà des adultes qui, eux, jouent aux échecs comme on marche au pas : en cadence, sans faute, mais sans folie. Fischer, lui, voit vingt coups d’avance, il est imprévisible. Il est tout sauf un joueur académique et n’a aucune idée de ce qu’est une poignée de main cordiale…
On dira plus tard qu’il était difficile, voire dérangé, fou. Sans doute.
L’Amérique face à elle-même… et à Moscou
Longtemps, Washington se méfie de ce joueur un peu trop marginal, trop insolent, trop anarchiste, trop brillant, trop juif pour certains, trop antisémite pour d’autres (oui, il réussira ce grand écart grotesque). Mais quand il devient la seule chance de battre les Soviétiques sur leur terrain, et qui jusqu’ici régnent en maîtres incontestés sur la discipline, on lui pardonne tout — son comportement de Prima donna, ses caprices, ses exigences absurdes, ses attaques contre les journalistes, et même ses retards à la pendule.
Fischer devient un symbole. Malgré lui, comme tous les vrais symboles. Il incarne l’individu libre contre la machine soviétique. Il affronte l’URSS non pas avec une armée, mais avec un cerveau de 1 500 grammes et une méfiance maladive envers à peu près tout ce qui respire.
Et il gagne. Spassky, homme d’honneur au demeurant, finit même par l’applaudir. Le Kremlin, lui, n’a pas du tout applaudi… À Washington, Nixon et Kissinger, qui féliciteront personnellement le héros, pavoisent ! En Occident, en général, et aux États-Unis, en particulier, Fischer devient alors le champion du monde libre !
L’arme inentendue de la Guerre froide
Car ne nous y trompons pas. Ce duel n’a rien d’anodin. À l’époque, les échecs sont pour les Soviétiques ce que le porte-avions est pour les Américains : un outil de projection de puissance. On y formait des grands maîtres comme on formait des colonels du GRU ou du KGB.
L’URSS avait mis en place une véritable politique d’État des échecs, avec financement, structures, écoles spécialisées et compétitions internes.
Le système formait des joueurs dès l’enfance, avec un encadrement pédagogique rigoureux, souvent comparable aux filières de sport-études.
Dans la logique de la guerre froide, l’Union soviétique utilisait ainsi les échecs comme un vecteur de soft power, pour démontrer la supériorité intellectuelle et culturelle du système socialiste.
La domination soviétique dans les compétitions internationales (notamment les championnats du monde de 1948 à 1990, avec des figures comme Botvinnik, Spassky, Karpov, Kasparov) participait de cette stratégie.
Bobby Fischer avait d’ailleurs accusé les Soviétiques de triche organisée lors des tournois internationaux, notamment les tournois de candidats (qui déterminaient le challenger au championnat du monde). Son accusation principale était que les joueurs soviétiques collaboraient entre eux, faussant ainsi la compétition…
En mai 1972, Richard Nixon est le premier président des États-Unis à se rendre en Union soviétique. C’est à cette occasion, qu’un premier traité de limitation des armes stratégiques (Salt I) est même signé entre les deux puissances. Une odeur de Guerre froide planait donc toutefois sur l’échiquier alors que les exigences de Fischer avaient créé des tensions et laissaient même penser, durant un moment, que le match serait annulé.
Quoi qu’il en soit, c’est le 1er septembre 1972 (le championnat a débuté le 11 juillet), que cette rencontre de titans se solde par la victoire de Fischer (12 points ½ contre 8 ½). Ce dernier devient ainsi le premier Américain à remporter le titre mondial aux échecs !
Fischer a triomphé de ce bras de fer cérébral, de cette 3e Guerre mondiale sur l’échiquier, et c’est un uppercut et un KO symbolique. Le monde entier comprend que le génie individuel peut vaincre l’appareil collectif, que l’improvisation peut vaincre le manuel, et que la folie peut battre la raison encadrée.
Dans une autre vie, Fischer aurait pu être un général atypique, un Patton dépressif, ou un Bonaparte paranoïaque. Or il avait choisi les échecs, probablement parce que là, au moins, les pions se taisent et les règles sont claires !
Les échecs, ce jeu d’hommes sérieux qui se regardent sans se parler…
Il faut dire un mot ici sur les vertus pédagogiques des échecs. Ce n’est pas qu’un passe-temps de lycéen letton. C’est une école de stratégie, de lucidité, de discipline mentale, de froideur et de sang-froid.
Et surtout, les échecs sont l’un des rares jeux où la chance n’a aucune place. Contrairement à des jeux comme le poker, les cartes ou même certains jeux de plateau, les échecs sont un jeu à information complète et sans hasard intégré. Ce n’est donc pas la belote : il n’y a pas de bol, pas de pioche, pas de hasard, pas de chance qui entre en ligne de compte. Vous faites une erreur et vous n’avez pas besoin du destin pour vous punir — votre adversaire s’en charge avec méthode et sans pitié !
Les échecs enseignent aussi le tempo, la dissuasion, l’attaque feinte, le sacrifice utile, la retraite tactique et surtout la patience, cette vertu cardinale qu’aucun homme politique moderne – surtout en Occident ! – ne maîtrise plus, trop occupé à tweeter sa grandeur.
Normal donc que les grands stratèges aiment les échecs. Clausewitz y aurait excellé, Kissinger aussi (lui préférait peut-être le bridge, mais pour manipuler les présidents…). Comme on dit dans les casernes : « Celui qui gagne sans tirer, c’est celui qui a bien préparé le terrain. » Et qui, souvent, a bien étudié l’ouverture de son adversaire.
Pas étonnant aussi que les échecs sont en Russie (et on l’a vu, historiquement en URSS) une discipline à part entière, à la fois sur le plan culturel, éducatif et géopolitique.
Dès l’époque soviétique, les échecs étaient intégrés dans la formation intellectuelle : ils étaient enseignés dans les écoles et les maisons de la culture.
Encore aujourd’hui, la Russie enseigne les échecs dans certaines écoles primaires comme matière obligatoire ou complémentaire, dans le but de développer les capacités cognitives des élèves. Quelle leçon !
D’ailleurs, il est important de noter ici une chose importante pour les analystes géopolitiques, et que certains « experts » idiots jugeaient avec dédain et faussement, n’être qu’un « argument de comptoir » : Sur trois siècles (1725–2025), la Russie a remporté environ 65 à 70 % des conflits qu’elle a menés, n’en a perdu que 5 à 10 %, tandis que 20 à 30 % restent indécis ou toujours en cours — une proportion qui s’accroît toutefois nettement à l’époque contemporaine.
Cette trajectoire historique s’inscrit dans une mentalité profondément marquée par le jeu des échecs, discipline nationale comme on l’a dit et qui a façonné le logiciel mental et stratégique russe, de leurs dirigeants, de leurs stratèges et de leurs officiers à travers les siècles.
Le Russe, adepte des stratégies d’usure et de patience, excelle dans l’art de l’attente et du pourrissement des rapports de force, lassant ses adversaires avant de porter le coup décisif. Spécialiste des fins de partie victorieuses, souvent au moment où tout semble perdu, il transforme les reculs tactiques en leviers de recomposition stratégique. La guerre actuelle en Ukraine, loin des narratifs dominants et de la propagande des Occidentaux, témoigne encore de cette logique… Enfin, passons…
Un Roi sans royaume
Fischer aurait pu devenir un héros national. Il est devenu un exilé. Il ne défend pas son titre, le perd donc et refuse tous les ponts d’or pour rejouer. Il disparait complètement du monde échiquéen. Il ne rejoue finalement qu’en 1992, en Serbie sous embargo, pour affronter de nouveau Spassky, et le gagne ! Garry Kasparov s’exclama alors : « Dieu est redescendu sur Terre ! »
Mais il continue à insulter tout le monde. Il fuit. Il déraille. Il parle d’un complot mondial, attaque les juifs (lui, le fils d’une juive !), vit dans des hôtels minables…
Plus tard, il insulte les États-Unis après le 11 septembre (une sortie d’une vulgarité rare), et finit, ironie du destin, réfugié politique… en Islande.
Il y mourut le 17 janvier 2008 à 64 ans, des suites d’une insuffisance rénale. A l’époque, certains relevèrent qu’il avait vécu autant d’années qu’un échiquier compte de cases…
À sa mort, l’ancien champion du monde Garry Kasparov déclara que « Fischer peut tout simplement être considéré comme le fondateur des échecs professionnels et sa domination, bien que de très courte durée, a fait de lui le plus grand de tous les temps ».
De fait, il n’a jamais été un modèle. Il a été une exception. Un éclair. Une météorite mentale. Et pendant un bref instant, il a incarné la puissance américaine sous sa forme la plus dérangeante : le génie rebelle et incontrôlable.
Fischer aujourd’hui…
Aujourd’hui on a un peu oublié Bobby Fischer. Depuis, d’autres grands maîtres sont devenus de véritables stars comme Anatoli Karpov, Garry Kasparov ou aujourd’hui Magnus Carlsen, aussi flamboyantes, géniales mais peut-être un peu plus sages et académiques… Quoique…
En attendant, à toute révolution ses excès… mais aussi ses vertus. Comme je le dis souvent, la grande révolution numérique en cours, malgré ses dérives et son côté obscur, a au moins le mérite de briser le monopole de l’information contrôlée par les États et les élites médiatiques.
Et dans ce grand bouleversement technologique historique, les échecs ont trouvé une seconde jeunesse. Portés par des films comme Pawn Sacrifice (le biopic de Fischer), des séries à succès comme Le Jeu de la dame sur Netflix, mais surtout par l’explosion des plateformes en ligne (Chess.com, Lichess) et la vitalité des blogs et chaînes YouTube spécialisés, le noble jeu est en train de se populariser et de devenir un phénomène mondial, accessible à tous. Grâce à cela, le nombre de licenciés est en nette progression à travers la planète !
Ironie de l’histoire : l’algorithme a rendu les échecs plus populaires que les manuels scolaires !
En 2025, il est bon de se souvenir qu’un jour, un homme seul, sans État-major ni lobby, a mis en échec l’Union soviétique. Non par hasard, mais parce que le jeu d’échecs reflète la vérité brutale du monde : il n’y a pas de place pour les faibles, ni pour les rêveurs.
On peut ne pas aimer Bobby Fischer. Mais on ne peut pas l’ignorer. Il fut le stratège involontaire d’une Amérique encore capable de produire du génie brut, sans storytelling ni coach en communication.
On l’a vu, les échecs ne sont jamais bien loin de la géopolitique. Aussi surprenant que cela puisse paraître, si les États-Unis demeurent encore aujourd’hui la grande puissance des échecs, devant l’Inde, la Chine et la Russie (la France est 8e) – un classement hautement symbolique et qui en dit beaucoup sur notre époque… -, ils le doivent assurément à Bobby Fischer. C’est son héritage, comme le rappelle si justement Julien Song, le Maître International français et célèbre Youtubeur.