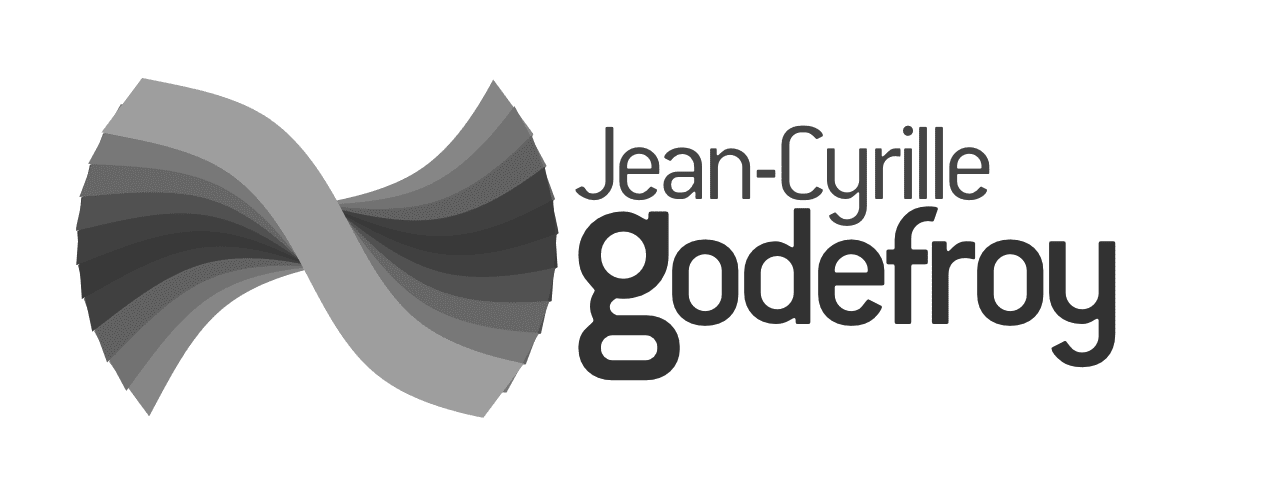Par Giuseppe Gagliano, Président du Centro Studi Strategici Carlo De Cristoforis (Côme, Italie)
27 juin 2025 / Le Diplomate
Le sommet de l’OTAN tenu à La Haye le 25 juin 2025 restera dans les mémoires non pour ses percées diplomatiques ou stratégiques, mais pour avoir exposé au grand jour les contradictions profondes d’une alliance en décalage croissant avec les réalités géopolitiques du XXIe siècle. En moins de 24 heures – un record en matière de brièveté – les dirigeants occidentaux ont validé un ensemble de décisions dont la portée semble davantage symbolique que stratégique.
Un objectif budgétaire irréaliste
L’élément central du sommet a été l’engagement à porter les dépenses de défense à 5 % du PIB d’ici 2035. Or, cet objectif, déjà qualifié d’inatteignable au moment même de son adoption, frôle l’absurde. Aucun État membre n’a encore atteint un tel niveau de dépenses (la Pologne étant la plus proche, à 4,7 %) et plusieurs pays, à commencer par l’Espagne de Pedro Sánchez, ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils ne s’y conformeraient pas.
Selon les calculs, si tous les membres de l’OTAN avaient consacré 3,5 % de leur PIB à la défense l’an dernier, cela aurait représenté environ 1 750 milliards de dollars. Passer à 5 % signifierait injecter plusieurs centaines de milliards supplémentaires chaque année – un effort budgétaire insoutenable pour la majorité des pays européens, surtout en contexte d’austérité, de vieillissement démographique et de crise sociale.
Plus révélateur encore : la ventilation proposée (3,5 % pour les dépenses militaires classiques, 1,5 % pour une catégorie floue couvrant « les infrastructures critiques, la cybersécurité, la résilience civile ») autorise toutes les contorsions comptables imaginables. Un artifice que l’Italie a déjà utilisé pour gonfler artificiellement son respect de la barre des 2 %.
L’illusion d’une (improbable) guerre gagnable contre la Russie
Toute la stratégie du sommet repose sur une hypothèse discutable : l’éventualité d’un affrontement militaire avec la Russie. Si la déclaration finale évoque « la menace à long terme que représente la Russie », elle omet soigneusement de parler de « guerre d’agression en Ukraine » – signe manifeste d’un malaise stratégique croissant au sein de l’Alliance. Cette prudence lexicale traduit le désengagement américain croissant, notamment celui de Donald Trump, qui rechigne à s’impliquer dans un bras de fer direct avec Moscou.
Trois ans de guerre, des dizaines de milliards de dollars d’aide militaire, des sanctions sans précédent… Et pourtant, la Russie non seulement tient bon, mais progresse sur le terrain. Croire que des hausses massives des budgets militaires suffiront à inverser la donne relève du pur fantasme. D’autant que les coûts des armements, des matières premières et de l’énergie ont triplé en Europe depuis le début du conflit.
Une diplomatie de l’humiliation
Le sommet, réduit à moins de 24 heures, avait pour but avoué d’éviter un retrait anticipé de Trump, comme cela s’était produit au G7 une semaine plus tôt. L’instant le plus révélateur ? Le message flagorneur envoyé par Mark Rutte au président américain, vantant « l’action décisive de Trump en Iran » et promettant que « l’Europe paiera en GRAND, comme elle le doit ». Trump, hilare, l’a publié lui-même sur ses réseaux. L’analyste Arnaud Bertrand a résumé la scène ainsi : « On a atteint le sommet du vassalisme européen. Même les serfs médiévaux avaient plus de dignité. »
Interrogé sur l’Article 5 du traité, fondement de la défense collective, Trump a botté en touche : « Cela dépend de votre définition », a-t-il répondu. Une déclaration qui jette une ombre sur la crédibilité même de l’Alliance.
L’Ukraine effacée de l’agenda
Autre non-dit majeur : l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN a été purement et simplement gommée. Si la déclaration finale réitère un soutien à Kiev, elle ne fait plus aucune mention d’une future intégration. Une volte-face spectaculaire comparée aux sommets précédents où cette adhésion était présentée comme une priorité stratégique.
Cette omission traduit un recul discret mais réel des ambitions occidentales : le soutien à l’Ukraine est désormais perçu comme un engagement de long terme, et non plus comme une passerelle vers une victoire rapide.
Crosetto : Le ministre qui ose dire ce que les autres pensent tout bas
Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a prononcé à l’Université de Padoue un discours que beaucoup jugeraient hérétique dans les cercles atlantistes. « La NATO n’a plus de raison d’être dans sa forme actuelle », a-t-il déclaré, dénonçant le fait que l’organisation reste sourde à l’évolution géopolitique mondiale : « Le centre du monde n’est plus l’UE ou les États-Unis. La NATO doit parler au Sud global ou disparaître. »
Il a ajouté : « La multilatéralité est morte. L’ONU ne compte plus, l’Europe encore moins. » Un constat brutal, qui souligne la perte d’influence des institutions internationales occidentales. Même si Crosetto a ensuite relativisé ses propos, le malaise persiste.
La Chine comme nouvel ennemi désigné
En perte de repères face à la Russie, l’OTAN semble vouloir justifier sa survie en désignant la Chine comme la prochaine menace structurelle. Mark Rutte, en bon élève du discours néoconservateur, a dénoncé la « militarisation sans précédent » de Pékin et prévenu que l’Occident devait se préparer à un conflit sur deux fronts.
Mais cette extension géographique du périmètre d’action de l’OTAN, censée être une alliance de défense nord-atlantique, confirme son glissement de plus en plus politique, au détriment de la cohérence stratégique. Une fuite en avant dans la rhétorique belliciste qui ne convainc guère les opinions publiques européennes.
Les vrais gagnants : Les industriels de l’armement
Dans ce théâtre d’ombres, un acteur tire néanmoins son épingle du jeu : le complexe militaro-industriel transatlantique. L’engagement pris d’« éliminer les barrières commerciales dans le secteur de la défense » et de « renforcer les partenariats industriels » est une bénédiction pour les géants de l’armement, américains en tête. Le géopolitologue et directeur de la rédaction du Diplomate, Roland Lombardi, le confirme. Pour lui, « c’est tout à fait clair que cette volonté générale de réarment tous azimuts en Europe contre la soi-disant menace russe qui n’est qu’un fantasme voire éminemment dangereuse si les Européens continuent à provoquer Moscou, et qui surtout n’a aucun fondement réaliste et va à l’encontre de tout bon sens géostratégique pour le Vieux continent, est le fait essentiellement de l’hyper-puissant lobbies militaro-industriels américains, toujours très influents auprès de la caste dirigeante à Bruxelles. Face à un Trump qui se veut faiseur de paix partout, les marchands de canons étatsuniens (qui avaient massivement financé la campagne de Harris !) ont trouvé la parade : se tourner vers les responsables européens malléables à merci. Car ne soyons pas naïfs. Je suis prêt à prendre le pari que plus de 60% des futures dépenses militaires de l’UE iront remplir les caisses des industriels outre-Atlantiques, cela se vérifie avec certaines commandes, depuis déjà de long mois, de plusieurs pays membres de l’UE… »
Avec le mot d’ordre de Rutte – « Unir, innover, livrer » – la défense collective cède la place à une guerre de production qui vise moins à défendre qu’à investir massivement des fonds publics dans les arsenaux privés.
*
L’OTAN au bord de l’obsolescence
Le sommet de La Haye a agi comme un miroir cruel. Loin de revigorer l’Alliance, il a montré une OTAN suspendue entre nostalgie et servitude, incapable d’assumer la mutation du monde. L’incapacité à réformer, l’obsession pour des objectifs irréalistes, la soumission à un leadership américain imprévisible et l’absence totale de vision stratégique font de l’Alliance atlantique un reliquat d’une ère révolue.
Comme l’a amèrement constaté Crosetto : « Nous sommes passés d’un monde où les valeurs comptaient, à un monde où seul compte le pouvoir économique ». Un monde dans lequel l’OTAN n’a peut-être plus sa place.