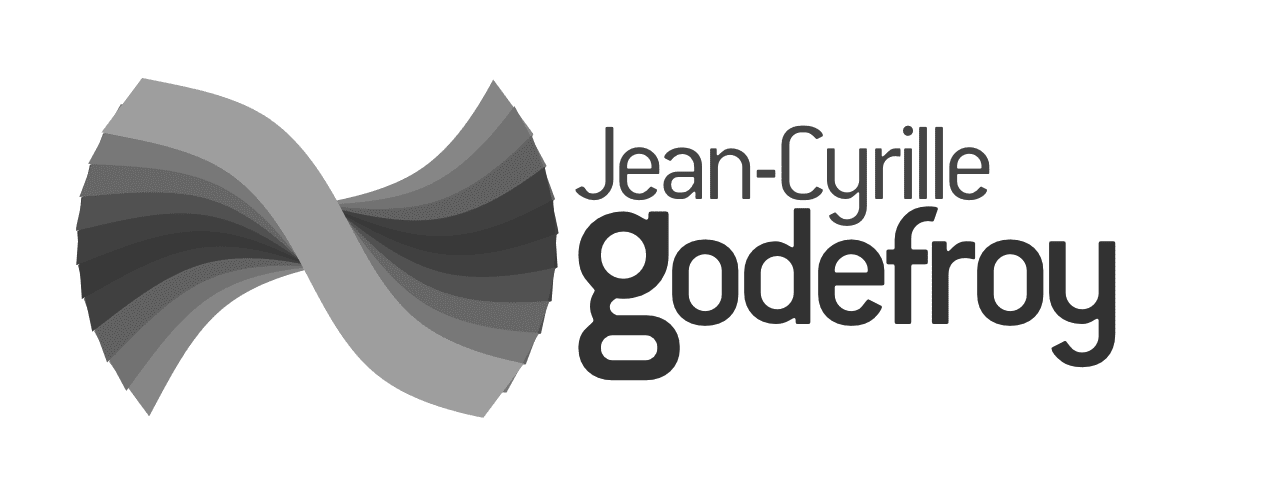L’Europe se rêvait puissance. Trump la fait atterrir : comme au bon vieux temps de la guerre froide, elle est redevenue un simple terrain de jeu pour les USA et la Russie. Thibault de Varenne nous décrypte le nouvel ordre international qui se met en place.
La relation entre les États-Unis de Donald Trump et la Russie de Vladimir Poutine ne s’analyse pas comme une série d’événements isolés, mais comme une trajectoire stratégique cohérente dont chaque étape renforce la précédente. Le sommet d’Anchorage du 16 août 2025 n’était pas une fin en soi, mais l’acte fondateur d’une nouvelle méthode diplomatique. L’échange téléphonique de plus de deux heures du 16 octobre n’était pas une simple conversation, mais l’aboutissement de cette séquence : la mise en œuvre d’une diplomatie du levier, bilatérale et brutale, qui redessine l’architecture de sécurité européenne en excluant délibérément ses principaux acteurs. Cette synthèse retrace l’évolution de cette dynamique, d’un accord de principe en Alaska à sa mise en application concrète en vue d’un sommet décisif à Budapest.
Anchorage, acte fondateur d’un « deal » bilatéral
Le sommet d’Anchorage, par sa brièveté et son opacité, a posé les bases de la relation actuelle. En moins de trois heures, Donald Trump et Vladimir Poutine ont validé une convergence d’intérêts fondamentale : la gestion des crises mondiales, et notamment de la guerre en Ukraine, doit se faire par des accords directs entre grandes puissances, en dehors des cadres multilatéraux jugés contraignants. Pour Poutine, le simple fait de se rendre en Alaska malgré un mandat d’arrêt international était une victoire diplomatique, brisant son isolement et le légitimant comme un interlocuteur incontournable.
Cette rencontre a été la manifestation la plus pure des doctrines respectives des deux dirigeants. D’un côté, le « réalisme transactionnel » de Donald Trump, qui perçoit la géopolitique comme une série de « deals » où il faut « limiter les coûts ». Pour lui, les territoires ukrainiens occupés sont un passif dont il faut se délester en échange de la fin des hostilités, et ses déclarations publiques sur la non-adhésion de l’Ukraine à l’OTAN ou sur le fait que la Crimée « est revenue aux Russes » constituent des concessions offertes en amont pour faciliter la transaction.
De l’autre côté, la vision de longue date de Vladimir Poutine d’un monde « multipolaire » ou « polycentrique », où la domination américaine est contrebalancée par d’autres centres de pouvoir, dont Moscou est un pôle essentiel. Le sommet d’Alaska a consacré cette vision, en forçant Washington à négocier d’égal à égal avec la Russie, par-dessus la tête des Européens. L’accord tacite d’Anchorage était donc simple : les États-Unis obtiennent une sortie du conflit ukrainien à moindre coût, et la Russie obtient la reconnaissance de sa sphère d’influence et la consécration de son statut de grande puissance. L’Europe, quant à elle, était réduite au rôle de spectatrice.
La possible « guerre grise » en Europe
La période qui a suivi le sommet d’Anchorage a été marquée par une accusation d’intensification de la « guerre grise » menée par la Russie contre l’Europe. La vague d’incursions de drones au-dessus des aéroports et des sites sensibles européens en septembre et octobre 2025 a été considérée comme le fait d’une stratégie russe, même si Elise Rochefort donne, dans nos colonnes, de bonnes raisons de se méfier de ce narratif.
Ces opérations s’inscrivent peut-être dans la doctrine de guerre hybride russe, qui combine des moyens militaires et non militaires pour déstabiliser l’adversaire en restant sous le seuil d’un conflit ouvert. Mais au fond, dans cette affaire, Russie et USA n’ont-ils pas des intérêts convergents ?

Cette possible campagne de drones (qu’elle soit d’origine russe ou sous « false flag ») a servi de toile de fond à la phase suivante de la négociation. Elle a contribué à créer un sentiment d’urgence et a mis en évidence l’incapacité de l’Europe à répondre de manière unifiée à une menace diffuse, renforçant ainsi la position de Trump comme seul acteur capable d’imposer un « deal » à Poutine.
L’appel du 16 octobre : la diplomatie du levier en action
L’échange téléphonique de près de deux heures et demie du 16 octobre 2025 entre Trump et Poutine a été le point culminant de cette stratégie, transformant les principes établis en Alaska en une négociation concrète basée sur des leviers de pression mutuels.
Initié par le Kremlin, l’appel a eu lieu la veille de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington. Ce dernier venait plaider pour la livraison de missiles de croisière Tomahawk, une arme à longue portée capable de frapper en profondeur le territoire russe et de changer la dynamique du conflit.
Donald Trump a utilisé cette demande ukrainienne comme son principal levier de négociation. En laissant planer la possibilité de fournir ces missiles, il a mis une pression directe sur Moscou. La menace n’était pas tant militaire que stratégique : la livraison de Tomahawks signifierait un engagement américain plus profond dans le conflit, une ligne rouge pour le Kremlin.
Face à cette menace, Vladimir Poutine a déployé une stratégie à deux volets :
- L’avertissement : le conseiller du Kremlin, Iouri Ouchakov, a clairement indiqué que la livraison de Tomahawks, bien que ne changeant pas l’issue sur le terrain, infligerait des « dommages substantiels » aux relations bilatérales et anéantirait les perspectives de paix. Poutine a renforcé ce message en affirmant à Trump que la Russie détenait « l’entière initiative stratégique » sur le terrain.
- L’incitation économique : simultanément, Poutine a fait miroiter à Trump des perspectives « énormes » pour la coopération économique entre les États-Unis et la Russie une fois le conflit terminé. C’était une offre parfaitement calibrée pour l’approche transactionnelle du président américain, transformant la paix en une opportunité d’affaires.
Le résultat : le sommet de Budapest
Le résultat de cet échange de leviers a été immédiat. Trump, qualifiant l’appel de « très productif« , a annoncé un nouveau sommet en personne à Budapest dans les semaines à venir. Son ton sur les Tomahawks a radicalement changé, exprimant publiquement des doutes sur la possibilité de « vider » les stocks américains pour l’Ukraine.
Le choix de Budapest est hautement symbolique. La capitale hongroise, dirigée par Viktor Orban, l’allié le plus proche de Poutine au sein de l’UE, permet de contourner le mandat d’arrêt de la CPI contre le président russe et d’acter la mise à l’écart définitive des capitales d’Europe occidentale dans le processus de négociation.

La séquence qui s’est déroulée entre le 16 août et le 16 octobre 2025 illustre une méthode diplomatique implacable. Le sommet d’Anchorage a défini le cadre : un dialogue bilatéral exclusif. La guerre hybride par drones a créé le contexte : une Europe sous pression et en quête de solutions. L’appel téléphonique a été l’exécution : un échange de menaces et de promesses où l’avenir de l’Ukraine est devenu une monnaie d’échange pour un accord global entre Washington et Moscou.
Le prochain sommet de Budapest ne sera pas une négociation sur l’Ukraine, mais la ratification d’un « deal » dont les termes ont été esquissés en Alaska et affinés par téléphone. Pour l’Europe, cet événement s’annonce comme une nouvelle étape de son déclassement stratégique. Après avoir été exclue des discussions, elle risque de devoir faire face à un accord conclu sans elle, mais qui déterminera l’avenir de sa propre sécurité. La diplomatie du levier de l’axe Trump-Poutine a non seulement marginalisé l’Europe, mais elle l’a transformée en un simple théâtre d’opérations pour une négociation qui la dépasse.