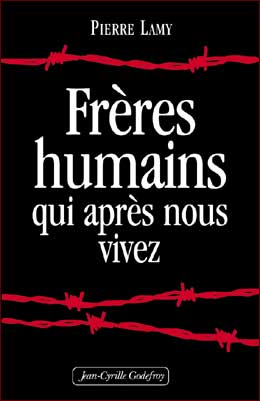Description
Les Borgia : une histoire de passion et de mort, de violence et d’extrême raffinement. Le pire a été dit sur cette grande famille ; il restait à écrire le plus noble. En un peu plus d’un siècle, de 1455 à 1572, les Borgia bondissent d’un seul coup sur le piédestal de la gloire ; partis de petits évêchés et de cardinalats, ils atteignent la terrible attitude du Trône de Pierre ; ils produisent en ces quelques années deux papes, un saint et un général des Jésuites.
Un pape licencieux et ses enfants, une fille perdue, un aventurier brutal, usant tour à tour du poison et de la dague au gré de leur passions ; stupre, scandale, violence, telle est l’auréole noire qui entoure les membres de la maison des Borgia.
Mais, champion du pape calomnié, Frederic Rolfe montre qu’Alexandre VI mit un terme à l’anarchie de Rome, arrangea ses affaires compliquées avec le royaume de Naples, et maria somptueusement a Giovanni Sforza sa fille Lucrezzia, âgée de 15 ans. De celle-ci il défend la mémoire en la décrivant « plus brillante par ses vertus que l’étoile de Rome », ainsi que celle de César Borgia, duc de Valentinois, soldat seulement un peu rude…
Spécialiste de la Renaissance, Frederic Rolfe plonge sans ménagement le lecteur dans l’univers convulsif et fascinant de l’Italie du XVe siècle.