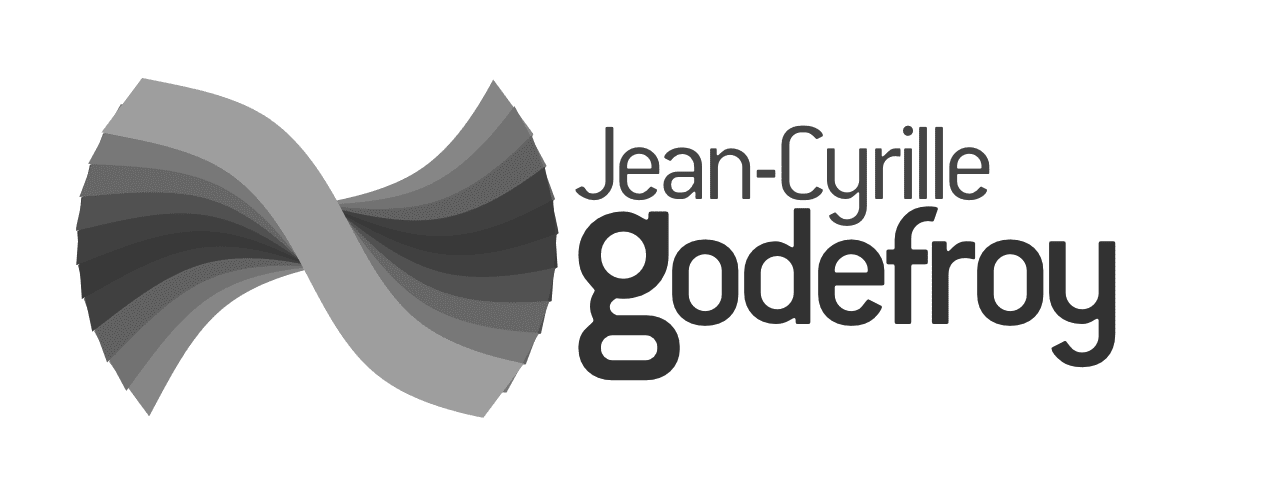14 mai 2025
Jean-Baptiste Noé
L’ouverture du conclave remet Rome au centre du monde. 133 cardinaux électeurs, venus de tous les continents, se retrouvent enfermés dans la chapelle Sixtine pour élire l’évêque de Rome, qui est la tête visible de l’Église catholique. La notion « d’Occident » m’a toujours semblé apporter plus de confusion que de clarté, c’est pourquoi je préfère celle de « romanité ».
À l’origine, l’Occident est un espace, il s’agit du monde latin de l’Empire romain, l’Orient étant la partie grecque. Aujourd’hui, le terme d’Occident renvoie aussi à une définition politique : le bloc occidental, que l’on oppose à d’autres. Mais définir l’Occident n’est pas évident, ce que j’avais pu évoquer dans un précédent article.
Qu’est-ce que la romanité
La romanité part de l’Empire romain et englobe à la fois l’Orient et l’Occident, la partie grecque et la partie latine de Rome. Elle est d’abord un héritage, celle de la Grèce, mais aussi celle des philosophies orientales, qui ont profondément imbibé le monde romain.
À ces fondements philosophiques et religieux, Rome a apporté une structure juridique ainsi qu’une vision urbanistique. La romanité s’exprime autant dans les idées : le droit, la famille, la pensée de la guerre, que dans la vie quotidienne : l’organisation des villes, la gastronomie (le vin, le repas), les modes vestimentaires, l’art. La romanité est une pensée politique, un mode de vie sociale, une vision du monde présent et de la mort. Elle s’est poursuivie dans l’Église catholique, qui est l’héritière de Rome. Non seulement parce que son siège est situé dans la Ville éternelle, mais aussi parce que ses langues sont le latin et le grec, que sa liturgie prend ses racines dans l’histoire profonde des mondes grecs et hébraïques, que les vêtements des prêtres, lors de la messe, sont des vêtements romains, issus de la toge et de la dalmatique.
La romanité est donc à l’origine la culture romaine, la manière d’être romain, exprimée dans un espace donné, celui de l’Empire romain. Avec la diffusion du christianisme et celle des Européens, la romanité se diffuse à son tour hors de son espace d’origine. Si bien qu’aujourd’hui, on est davantage en terre romanisée à Buenos Aires qu’à Tanger, à Hong Kong qu’au Caire. La romanité n’est pas l’Occident, car son sens se comprend dans une définition moins politique et idéologique. La romanité touche aussi aux modes de vie, aux façons d’être, de penser le monde.
Critères de la romanité
On peut retenir plusieurs critères pour définir la romanité.
Le premier est celui de la sphère culturelle : la romanité se rattache à l’Empire romain, à son histoire et à sa mythologie. De là découle une philosophie, issue de la Grèce, de ses mythes et de ses histoires, mais aussi de la littérature romaine (comme Virgile). Cette sphère culturelle concerne tous les domaines de l’art : la littérature, la peinture, l’architecture, le cinéma, la photographie, etc.
Le deuxième critère est celui des modes de vie. La romanité s’exprime notamment dans les repas, qui est le moment social et culturel par excellence. Autour de ces repas, le vin a toute sa place, lui qui est la boisson phare de Rome, jusqu’à devenir le sang du Christ dans la religion chrétienne. Jules César disait que la frontière entre la civilisation et la barbarie était celle du vin et de la bière, tant dans le monde romain le vin est associé à la civilité. Partout où il y a de la vigne, il y a la romanité. Les religions qui interdisent l’usage du vin, comme l’islam, et les régions où la vigne est absente, comme la Chine, ont défini d’autres critères sociaux et normatifs pour leurs repas, qui sont là aussi des moments de convivialité, mais hors de l’espace mental de la romanité.
Au vin s’ajoutent les céréales, notamment le pain, sous toutes ses formes, la place du théâtre et des loisirs dans la cité.
Le troisième critère est celui du droit. L’idée de fonder une société sur le droit, ce qui suppose le respect de la personne et sa défense par rapport au groupe. Le droit romain permet l’émergence de l’individu sur la tribu, la définition de la famille monogame et donc, avec le monde chrétien, l’égalité de nature entre l’homme et la femme.
Le quatrième critère est celui de l’apport du christianisme comme héritier et perpétuateur de Rome. En se diffusant, le christianisme permet la diffusion de la romanité, à condition de modifier en profondeur les modes de vie et de pensée selon les autres critères de la romanité. En Afrique noire, par exemple, bien que la couche chrétienne soit présente depuis près de 150 ans, la romanisation demeure superficielle et fragile.
Le cinquième critère est celui du rapport de la ville et de la campagne. Comme lieux de production, de commerce, d’échanges, villes et campagnes sont profondément imbriquées. La ville est le creuset de la civilité, de l’urbanité, c’est-à-dire de la manière d’être. La pensée romaine de la ville se retrouve dans les mégapoles américaines et brésiliennes. La ville n’est pas uniquement un espace d’habitat, mais aussi une façon de penser l’homme, l’architecture étant une pensée anthropologique exprimée dans la pierre.
Le sixième critère est celui de la permanence mémorielle de la Méditerranée. La romanité s’exprime aujourd’hui bien loin de son espace méditerranéen d’origine, mais elle n’est pas qu’une pure idée détachée des lieux et de l’espace. Si elle s’étend au-delà de la Méditerranée, le mare nostrum demeure comme références culturelles et nostalgiques. On le voit à travers les films américains, dont plusieurs se déroulent en Méditerranée. La Californie, et notamment Hollywood, fut pensée comme une autre riviera. Quant à la Côte d’Azur, elle attire chaque année des milliers de touristes européens du nord de l’Europe. Si les Anglais ont autant voulu contrôler Malte et Suez, si l’Allemagne s’est entichée de contrôler Tanger c’est aussi parce que ces deux pays septentrionaux voulaient se rattacher à l’espace méditerranéen. D’une certaine façon, la romanité est une Méditerranée étendue.
Ces six critères permettent de comprendre que la romanité est beaucoup plus qu’un concept idéologique. C’est un concept culturel, social, politique au sens du politique et non pas de la politique. Un concept géopolitique qui permet de comprendre le monde dans sa diversité et sa globalité.