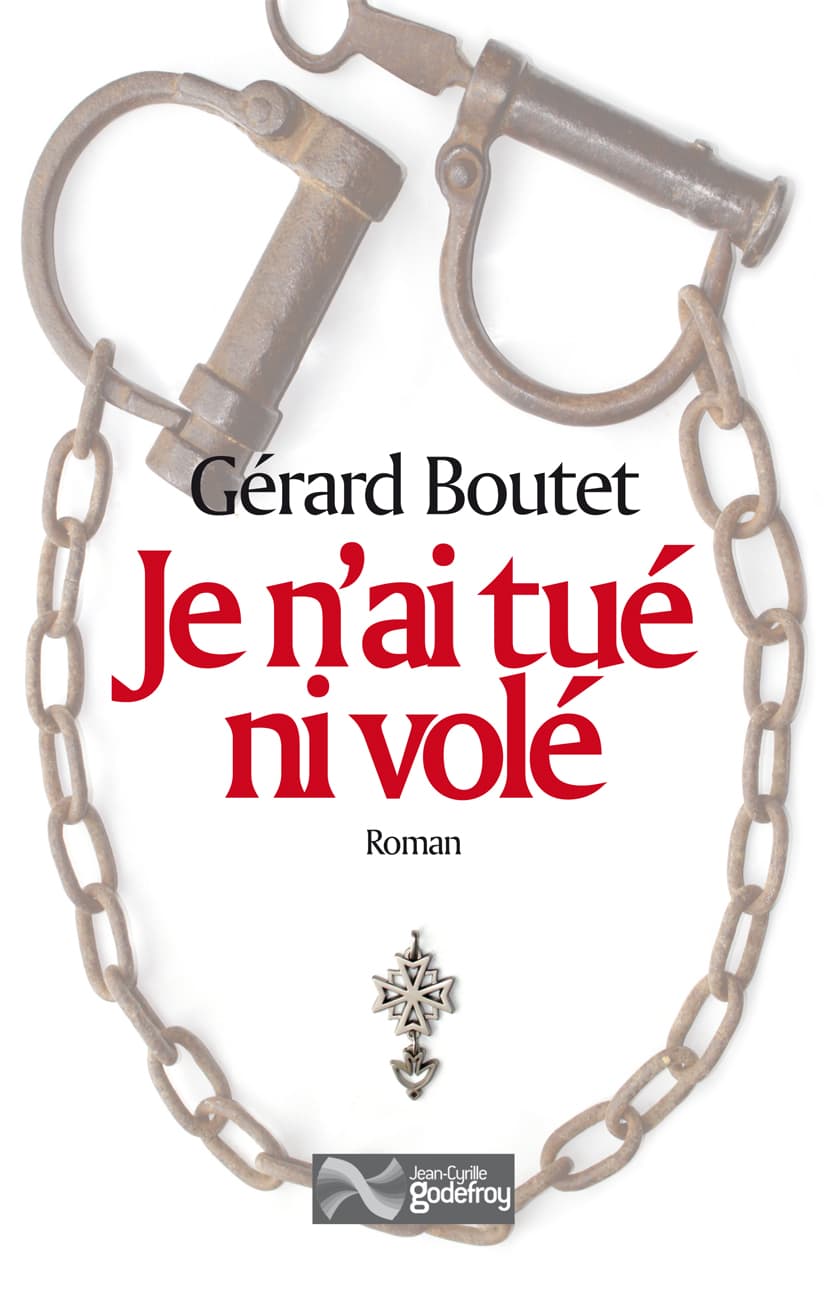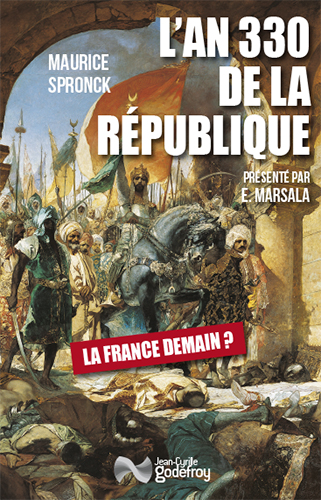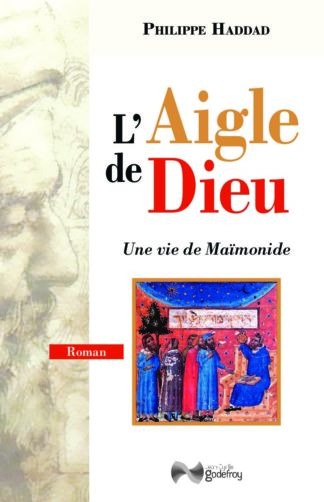Description
Aucun romancier n’aurait osé imaginer la vie d’un personnage aussi étonnant que Bernard de La Serre. Cette fois encore, la réalité dépasse la fiction !
Fils d’un modeste métayer du Béarn, Bernard de La Serre est né en 1646. Rien ne le disposait à vivre de telles tribulations. Qu’on en juge plutôt !
Après le séminaire où on l’a placé de force, il devient chapelain du régent d’Espagne, ce qui constitue déjà un avancement prodigieux. Les épisodes qui suivent ne sont pas moins surprenants.
L’abbé est capturé par les Barbaresquesdu Maroc, dans les bagnes desquels il croupit pendant cinq années. Racheté par les Trinitaires, il regagne la France où il obtient un confessionnal en l’église Saint-Roch, à Paris. C’est là que, dix années durant, il devient le directeur de conscience de Monsieur, le frère de Louis XIV. Or, de conscience, Monsieur n’en a guère. Les scandaleux secrets que détient l’abbé de La Serre lui valent d’être relégué en une paroisse reculée de l’Orléanais — l’envoyer dans la lune n’aurait pas été pire.
Perdu dans l’immensité de la Beauce, le prêtre sent se réveiller ses origines béarnaises, fortement teintées de calvinisme. Le voilà qui accepte de marier les protestants des alentours. Ce crime abominé lui cause quelques alarmes, sans pour autant le détourner de sa complaisance envers les huguenots.
Le chanoine Bégon, cousin des Colbert, jure la perte du fraudeur, qu’il dénonce au marquis de Pontchartrain. Le cas devientune affaire d’État. L’abbé de La Serre est saisi au corps, embastillé, condamné aux galères à perpétuité. Il meurt à 61 ans, dans les fers de l’arsenal de Toulon, en 1707.
Ce personnage haut en couleur était connu des historiens et des généalogistes, mais le manque de documents empêchait d’approfondir les recherches. L’affaire dite « du curé de Nids » restait une énigme.
Gérard Boutet a eu une chance inouïe : celle d’exhumer des archives judiciaires jusqu’alors inédites. Ainsi a-t-il pu mener une véritable enquête policière et reconstituer l’itinéraire de ce prêtre atypique. Il s’est déplacé en Béarn, en Castille, en mille endroits où Bernard de La Serre s’était aventuré.
Le livre qui en résulte ne pouvait que prendre le ton d’un roman picaresque.